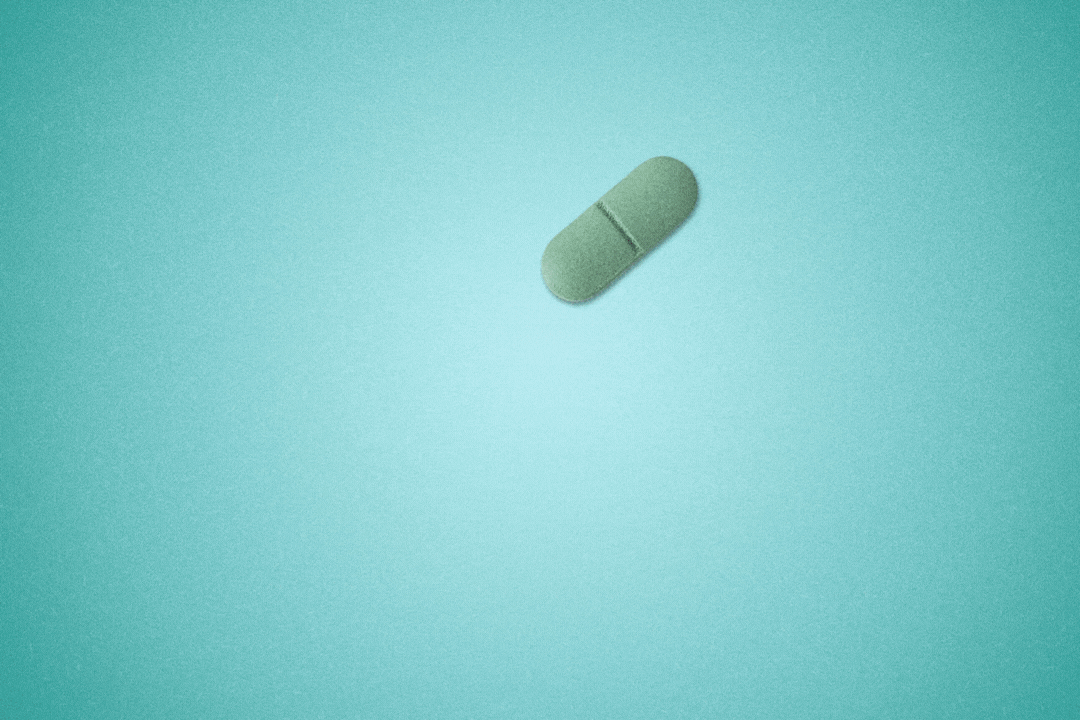Opinion
Frédéric Encel : « Donald Trump n’a pas d’approche diplomatique des relations internationales »

Photo: Crédit photo : Frédéric Encel
ENTRETIEN – la tournée du président américain dans les pétromonarchies du Golfe qui a eu lieu du 13 au 16 mai a été marquée par la signature de divers contrats. Donald Trump avait notamment annoncé le 13 mai la signature d’un partenariat stratégique avec Riyad de 600 milliards de dollars. Des contrats d’une valeur de 1200 milliards de dollars ont également été signés avec Doha.
Frédéric Encel est docteur HDR en géopolitique spécialiste du Moyen-Orient, enseignant à Sciences Po et auteur de nombreux ouvrages, en dernier lieu La guerre mondiale n’aura pas lieu (Odile Jacob, 2025). Il estime que le mercantilisme absolu est la seule boussole géopolitique du président américain.
Epoch Times : Donald Trump est-il en train de redéfinir la politique américaine au Moyen-Orient ?
Frédéric Encel : Absolument pas. Il ne fait qu’accroître ce qui a toujours existé et prévalu entre les États-nations qui, comme le disait Hegel, n’ont que des intérêts, c’est-à-dire le commerce. Donald Trump accélère ce phénomène de manière spectaculaire parce que le mercantilisme absolu est sa seule boussole.
Les États-Unis ont toujours entretenu des liens commerciaux forts avec les pays du Moyen-Orient, et notamment l’Arabie Saoudite et ce, depuis les années 1930.
L’Arabie Saoudite a toujours été le prisme moyen-oriental principal de Donald Trump, bien loin devant Israël.
Il faut se souvenir que son premier voyage officiel lors de son précédent mandat eut lieu à Riyad. Le président américain sait que l’Arabie Saoudite est un pays solvable. Par conséquent, il revient cultiver cette relation commerciale durable.
Au fond, Donald Trump souhaite que les États continuent d’investir en Amérique et achètent beaucoup de services et de matériels américains. C’est notamment le cas des pétromonarchies du Golfe, mais aussi du Japon, de la Corée du Sud, Singapour et de l’Australie qu’il voit comme dépendants des États-Unis pour leur sécurité et donc comme de bons clients.
Cependant, précisons une chose. Quand certains parlent de tournée de Donald Trump au Moyen-Orient, ce n’est pas tout à fait exact. Il ne s’intéresse qu’à certains États de la région, notamment les plus riches. Il n’accorde pas réellement d’importance à la Jordanie et au Sultanat d’Oman, par exemple.
La politique de Donald Trump s’inscrit donc dans une stratégie commerciale classique ?
Oui tout à fait. Cette stratégie nous paraît outrancière parce que, contrairement à ses prédécesseurs, il accorde une importance capitale au commerce. En réalité, il n’a pas d’approche diplomatique des relations internationales.
Cette tournée peut-elle également être interprétée comme une manière pour les États-Unis d’affirmer leur supériorité face à l’Iran ?
Il n’a pas besoin de se déplacer en Arabie Saoudite pour démontrer une forme de supériorité.
Quoi qu’il en soit, Donald Trump ne veut pas la guerre, ni avec l’Iran, ni avec personne. Il a toujours dit qu’il n’enverrait aucun soldat hors des frontières américaines parce qu’une guerre coûte trop cher. En partant de ce constat, on peut imaginer qu’il préfère passer par la voie de la négociation avec Téhéran.
Donald Trump a également surpris en annonçant la levée des sanctions contre le nouveau régime syrien. Quel est aujourd’hui l’intérêt pour l’Amérique de renforcer ses liens avec Damas ?
La Syrie d’aujourd’hui est celle d’avant Hafez el-Assad. C’est l’un des pays les plus pauvres du monde. Cependant, pour des raisons politiques, l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Turquie vont financer une grande partie de la reconstruction du pays.
Ainsi, la Syrie deviendra, à son tour, solvable, et les entreprises américaines vont se ruer dessus.
Par ailleurs, Mohammed ben Salmane a lui-même demandé à Donald Trump de reconnaître le nouveau régime en place à Damas. Pour les raisons que nous avons déjà évoquées, le président américain ne refuse pas grand-chose au prince héritier saoudien.
Parlons désormais de l’Ukraine. Donald Trump a récemment accusé Vladimir Poutine « d’être devenu complètement fou ». Est-ce un revirement de la part du président américain ?
Bien subtil serait celui qui pourrait vous l’affirmer avec certitude. Il y a deux scenarii possibles : soit, il organise son imprévisibilité, ce qui ne serait pas stupide d’un point de vue stratégique ; soit il est doté d’un ego surdimensionné et a été plus que vexé par le refus russe de sa proposition de cessez-le-feu.
Ce dont je suis certain, c’est que Donald Trump est fidèle à son absence de vision diplomatique et qu’il dit ce qu’il a sur le cœur.
Si demain le leader russe accepte la proposition de cessez-le-feu, on peut très bien imaginer le président américain rechanger de ton et recommencer à tresser des couronnes à Vladimir Poutine.
Mais Vladimir Poutine ne souhaite pas la fin de la guerre…
La fin de la guerre non, mais la fin des combats, je pense que si. Il y a une différence substantielle entre les deux. Un cessez-le-feu n’est qu’un acte militaire sur un front qui continue d’exister.
Puis, au regard des revers subis par les troupes du Kremlin depuis trois ans, j’ai le sentiment que le Kremlin ne dirait pas non à un arrêt des combats. Les 40 bombardiers russes mis hors de combat par les Ukrainiens il y a quelques jours démontrent une fois de plus la fragilité du système militaire russe. Un cessez-le-feu n’engage pas politiquement à reconnaître la légitimité de l’autre. Ce qui n’est pas le cas d’un traité de paix.
Contrairement à ce qu’il fait raconter à son ministre des Affaires étrangères, Vladimir Poutine ne veut effectivement pas de traité de paix. Il ne reconnaît pas la nation ukrainienne comme telle.
Aujourd’hui, le président américain a-t-il les moyens de mettre un terme à ce conflit ?
Donald Trump s’est lui-même affaibli en rejetant toute possibilité d’envoi de troupes. Il s’est, par ailleurs, adressé à Vladimir Poutine comme à un dirigeant occidental tout à fait respectable en omettant le fait qu’il avait en face de lui un dictateur impérialiste, nostalgique de l’Union soviétique et de la Russie de Catherine II.
Voyant cela, il y a fort à parier que Vladimir Poutine se soit dit qu’il pourrait gagner encore plus de temps.
Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles d’Epoch Times.

Articles actuels de l’auteur