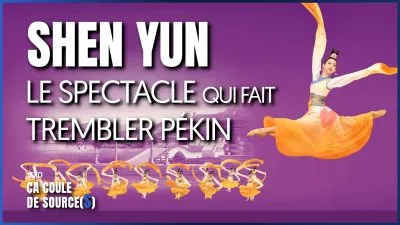Opinion
Notre addiction invisible mais omniprésente à la dopamine

Illustration
Photo: Shutterstock
Dans notre monde hyperconnecté, les smartphones sont devenus des extensions de nous-mêmes. Que ce soit pour vérifier une information, naviguer sur Instagram et X, ou répondre à un message WhatsApp, ces gestes sont devenus notre quotidien.
Mais derrière cette apparente banalité se cache un mécanisme puissant : les boucles de rétroaction dopaminergiques. Ces processus neurologiques, qui régissent notre quête de récompense, sont exploités avec une précision chirurgicale par les concepteurs d’applications et de réseaux sociaux de la Big Tech.
Derrière le rideau de gestes machinaux se niche une addiction silencieuse qui nous rend de plus en plus dépendant, nous fait perdre de plus en plus notre attention et augmente de plus en plus notre stress.
La dopamine, moteur de nos désirs
Pour comprendre les boucles de rétroaction dopaminergiques, il faut d’abord s’intéresser à la dopamine elle-même. Ce neurotransmetteur, souvent surnommé « l’hormone du plaisir », joue un rôle clé dans le système de récompense du cerveau. Lorsque nous accomplissons quelque chose d’agréable – manger un bon repas, recevoir un compliment ou gagner une partie de jeux –, notre cerveau libère de la dopamine, ce qui nous procure une sensation de satisfaction et nous incite à répéter l’action.
Mais la dopamine n’est pas seulement liée au plaisir. Comme l’explique le neuroscientifique Robert Sapolsky, elle est davantage associée à l’anticipation de la récompense qu’à la récompense elle-même. C’est cette anticipation qui nous pousse à vérifier nos notifications ou à rafraîchir notre fil Twitter (X), même lorsque nous savons qu’il y a peu de chances d’y trouver quelque chose d’important.
Ce mécanisme est au cœur des boucles de rétroaction dopaminergiques, qui se structurent en trois étapes : un déclencheur (une notification, par exemple), une action (ouvrir l’application), et une récompense (un like, un message ou un contenu intéressant).
Selon une étude de l’Université de Stanford (2021), les utilisateurs consultent leur smartphone en moyenne 150 fois par jour, souvent sans raison précise, mus par cette attente dopaminergique.
Les réseaux sociaux, des machines à dopamine
Les concepteurs d’applications et de réseaux sociaux comprennent parfaitement ce mécanisme. Ils utilisent des techniques issues des sciences comportementales et de la psychologie pour maximiser notre engagement. Prenez l’exemple du « pull-to-refresh », cette action de tirer vers le bas pour actualiser un fil d’actualité. Ce geste, inspiré des machines à sous, crée une incertitude : qu’est-ce qui va apparaître ? Un mème hilarant ? Une nouvelle dramatique ? Cette variabilité dans les récompenses est cruciale, car, comme l’a montré le psychologue B.F. Skinner dans ses expériences sur le conditionnement, les récompenses imprévisibles sont bien plus addictives que les récompenses régulières.
Un autre exemple frappant est celui des notifications. Les alertes push, avec leurs sons et vibrations, agissent comme des déclencheurs externes qui interrompent notre attention et nous incitent à vérifier notre téléphone. Même les notifications neutres, comme « Untel a aimé votre photo », suffisent à activer une petite décharge de dopamine. Et lorsque nous ne recevons pas de notifications, l’absence de récompense peut créer une forme d’anxiété, nous poussant à vérifier ou à publier encore plus souvent.
Les algorithmes des plateformes comme TikTok, Instagram, Facebook ou YouTube amplifient ce phénomène. Ces algorithmes analysent nos comportements – les vidéos que nous regardons, les publications que nous aimons, le temps que nous passons sur chaque contenu – pour nous proposer du contenu toujours plus captivant. Résultat : nous restons scotchés à nos écrans, enchaînant les vidéos ou les posts sans même nous rendre compte du temps qui passe, à la recherche du nouveau post inédit et intéressant. Comme le dit Tristan Harris, ancien designer éthique chez Google et cofondateur du Center for Humane Technology, « les réseaux sociaux ne sont pas des outils neutres. Ce sont des machines conçues pour manipuler notre attention. »
Les conséquences sur notre cerveau et notre comportement
Si les boucles de rétroaction dopaminergiques sont si efficaces, c’est parce qu’elles exploitent des mécanismes évolutifs anciens. À l’époque préhistorique, la quête de récompenses – trouver de la nourriture, éviter les prédateurs – était essentielle à la survie. Mais dans un monde où les récompenses numériques sont disponibles à l’infini, ces mécanismes peuvent devenir problématiques.
L’une des conséquences les plus documentées est la diminution de notre capacité d’attention. Une étude de l’Université de Californie à Irvine a montré que les interruptions constantes causées par les notifications réduisent notre productivité et augmentent notre stress. En moyenne, il nous faut 23 minutes pour retrouver notre concentration après avoir été distraits par une alerte. À force de zapper d’une application à l’autre, notre cerveau s’habitue à un mode de fonctionnement fragmenté, ce qui rend plus difficile la réalisation de tâches nécessitant une attention soutenue, comme lire un livre ou résoudre un problème complexe.
Les réseaux sociaux peuvent également affecter notre santé mentale. Une étude publiée dans The Lancet en 2019 a établi un lien entre l’utilisation intensive des réseaux sociaux et une augmentation des symptômes d’anxiété et de dépression chez les adolescents. Les boucles dopaminergiques jouent un rôle dans ce phénomène : la quête incessante de likes et de validation sociale peut créer un sentiment d’insatisfaction chronique, surtout lorsque les récompenses attendues ne sont pas au rendez-vous.
Chez les plus jeunes, les effets sont particulièrement préoccupants. Le cerveau des enfants et des adolescents est encore en développement, notamment le cortex préfrontal, qui régule les impulsions et la prise de décision. Une surstimulation dopaminergique à cet âge peut perturber ces processus, augmentant le risque de comportements addictifs. C’est pourquoi des experts, comme la psychologue Jean Twenge, appellent à limiter l’exposition des enfants aux écrans, en particulier aux réseaux sociaux.
Les effets sur la santé mentale et la productivité
Les boucles dopaminergiques ne se contentent pas de fragmenter l’attention ; elles affectent également la santé mentale, ce qui a des répercussions indirectes sur la productivité. La surstimulation causée par les réseaux sociaux peut entraîner stress, anxiété et fatigue mentale, réduisant la capacité à travailler efficacement.
Une étude publiée dans The Lancet (2019) a montré que l’utilisation prolongée des réseaux sociaux chez les adolescents était associée à une augmentation des symptômes dépressifs, ce qui peut se traduire par une baisse de motivation et d’énergie pour les tâches productives. Chez les adultes, le sentiment d’être constamment « en retard » sur les notifications ou les fils d’actualité peut générer une pression chronique, connue sous le nom de « FOMO » (Fear of Missing Out / Peur de passer à côté).
De plus, la surconsommation de contenu numérique peut perturber le sommeil. L’exposition à la lumière bleue des écrans et l’activation dopaminergique avant le coucher retardent l’endormissement, réduisant la qualité du sommeil. Or, un sommeil insuffisant est directement lié à une baisse de la productivité, avec des effets sur la mémoire, la prise de décision et la créativité.
Comment reprendre le contrôle ?
Si les boucles de rétroaction dopaminergiques sont puissantes, elles ne sont pas insurmontables. La première étape pour reprendre le contrôle est de prendre conscience de nos habitudes.
Des outils comme « Screen Time » (« Temps d’écran ») ou des applications tierces comme Freedom ou Forest, peuvent aider à surveiller où va votre temps. Mais au-delà des outils, c’est une question de discipline personnelle et de réinvention de notre relation avec la technologie.
Voici quelques stratégies concrètes pour réduire l’impact des boucles dopaminergiques. Vous pouvez désactiver les notifications non essentielles. Les notifications « push notifications » sont conçues pour interrompre votre attention. En les désactivant, vous reprenez le contrôle sur quand et comment vous utilisez votre téléphone.
Vous pouvez créer des zones sans écrans. Réservez des moments ou des espaces – comme la chambre ou les repas – où les smartphones sont interdits. Décidez à l’avance combien de temps vous souhaitez passer sur une application et respectez cette limite. Cela permet d’avoir plus de moments de connexion réelle avec les autres et avec soi.
Vous pouvez privilégier des activités à récompense lente mais qui sont meilleures sur le long terme pour l’organisme. Les réseaux sociaux offrent des gratifications instantanées, mais des activités comme l’écriture, la lecture, les exercices physiques, la méditation, les activités de groupe, la marche en pleine nature ou dans un parc, etc. procurent une satisfaction plus durable.
Pour les parents, il est crucial d’accompagner les enfants dans leur utilisation des technologies. Fixer des règles claires, comme pas d’écrans avant un certain âge ou des limites de temps quotidiennes, est essentiel. Mais il est tout aussi important de donner l’exemple : un parent qui passe ses soirées à naviguer sur son téléphone aura du mal à imposer des restrictions à ses enfants.
Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles d’Epoch Times.
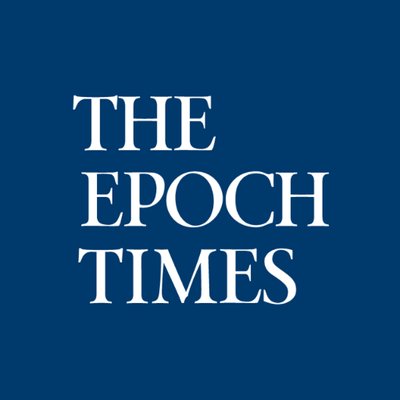
Histoire et philosophie des sciences, Science de l'information. Actualités française et internationale.
Articles actuels de l’auteur