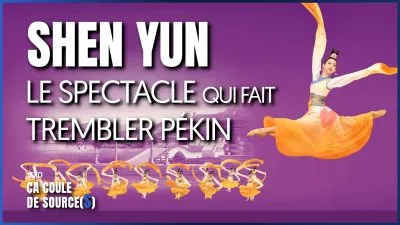Opinion
Universités américaines : quand la diversité divise

L'université de Columbia à Manhattan, New York, le 10 mai 2021.
Photo: Samira Bouaou/Epoch Times
Lorsqu’il a été récemment rapporté que des manifestants avaient perturbé la cérémonie de remise des diplômes de l’Université de Columbia, j’ai eu envie de demander : laquelle ?
En plus de sa cérémonie principale, Columbia organise pas moins de 10 cérémonies de remise des diplômes distinctes, souvent appelées remises de diplômes « affinitaires ». Celles-ci incluent des événements distincts pour les étudiants noirs, latinos, asiatiques, LGBTQIA+, juifs, autochtones, internationaux, handicapés ou autres.
Alors que Columbia affirme que ces cérémonies ont une «longue histoire » au sein de l’université, cette pratique ne remonte en fait qu’à 2005.
Columbia a été fondée en 1754. Pendant plus de 250 ans, l’université a organisé une seule cérémonie de remise des diplômes sans distinction de race, d’origine ethnique ou d’identité de genre.
Mais Columbia a choisi de séparer, voire ségréguer, les étudiants en fonction de la race ou d’autres caractéristiques personnelles.
D’autres universités américaines font de même : l’Université de Princeton, l’American University, la Penn State University, l’Université du Colorado, la Fresno State University et le College of William and Mary, organisent toutes des cérémonies de remise des diplômes basées sur des critères identitaires.
Ces programmes privilégient l’identité individuelle au détriment de l’expérience étudiante collective et commune, divisant le campus en silos démographiques et sapant les valeurs partagées, les réalisations et le sentiment de communauté que l’enseignement supérieur est censé cultiver.
Aux États-Unis, la ségrégation volontaire des étudiants ne se limite pas aux programmes de remise des diplômes. Dans l’ensemble de l’enseignement supérieur, les étudiants sont répartis dans des logements, des programmes d’orientation et des organisations étudiantes en fonction de leur race et d’autres facteurs identitaires.
Ce qui est étonnant dans cette pratique, c’est qu’elle est menée par l’industrie même de l’enseignement supérieur qui a longtemps proclamé la valeur indispensable de la diversité et de l’inclusion des étudiants.
On nous dit depuis des années que la création de diversité dans l’enseignement supérieur est essentielle à l’expérience éducative et prépare les étudiants à participer à une société de plus en plus complexe et pluraliste.
Selon Lee Bollinger, ancien président de l’Université du Michigan et de l’Université Columbia, la diversité raciale « est vitale » pour l’expérience étudiante. « La diversité n’est pas simplement un ajout souhaitable à une éducation complète. Elle est aussi essentielle que l’étude du Moyen Âge, de la politique internationale et de Shakespeare. »
Paul Alivisatos, président de l’Université de Chicago, considère la diversité et l’inclusion raciales comme essentielles à la mission éducative de son institution, la décrivant comme « fondamentale à notre succès académique » et « offrant une éducation transformative à nos étudiants ».
Pourtant, alors que l’enseignement supérieur continue de défendre la diversité raciale comme étant fondamentale à sa mission, ses pratiques actuelles révèlent une contradiction troublante.
Les institutions ne peuvent pas réaliser la promesse fondamentale selon laquelle la diversité favorise une plus grande connexion et une compréhension mutuelle entre les étudiants si elles promeuvent ou permettent la division et la désunion basées sur les caractéristiques mêmes que la diversité est censée embrasser.
Si la diversité doit avoir une réelle valeur pour l’expérience éducative, elle ne peut être réalisée en divisant les étudiants en groupes démographiques et en les « célébrant » de manière isolée.
Au contraire, elle exige de rassembler les gens – au-delà des lignes de race, de classe, de genre et d’idéologie – pour s’engager dans le travail difficile, désordonné et stimulant d’apprendre les uns des autres en tant qu’individus.
Il y a plus de vingt ans, un des juges de la Cour suprême des États-Unis, Antonin Scalia, a rendu une opinion dissidente qui a fait grincer des dents. Il appelait l’enseignement supérieur à ne pas ségréger les étudiants en fonction de la race sous prétexte de promouvoir la diversité et l’inclusion des étudiants.
Sceptique quant à l’utilisation de la race comme facteur dans les admissions universitaires pour créer de la diversité, Scalia avait fermement dénoncé « ces universités qui parlent de multiculturalisme et de diversité raciale devant les tribunaux, mais qui pratiquent le tribalisme et la ségrégation raciale sur leurs campus par le biais d’organisations étudiantes réservées aux minorités, de logements distincts pour les minorités, de centres étudiants distincts pour les minorités, voire de cérémonies de remise des diplômes distinctes réservées aux minorités. »
Aujourd’hui, avec le recul, ces paroles semblent prophétiques et jettent une ombre sur la tendance actuelle à la ségrégation raciale prévalant dans l’enseignement supérieur américain.
Cela soulève également des questions légitimes sur les risques qu’une fois diversifiée l’université ne mette en place des programmes d’enseignement qui introduisent toujours plus d’auto-ségrégation.
En fin de compte, l’enseignement supérieur américain veut le beurre et l’argent du beurre. Il est difficile, d’une part, de défendre la diversité comme une force unificatrice et fondamentale à sa mission éducative, tout en promouvant et en encourageant, d’autre part, des pratiques qui fragmentent les étudiants selon les lignes d’identité et de différence, sapant la mission même qu’il prétend défendre.
Kenneth A. Tashjy est avocat et consultant en enseignement supérieur, et ancien conseiller juridique général pendant plus de 20 ans pour 15 établissements américains d’enseignement supérieur.
Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles d’Epoch Times.

Kenneth Rapoza est rédacteur indépendant pour NTD. Il a été journaliste pour le WSJ au Brésil et a ensuite travaillé de 2011 à 2020 en tant que journaliste sur les BRIC pour Forbes. Il écrit des éditoriaux occasionnels pour Newsweek sur le programme commercial de Donald Trump et est analyste à la Coalition pour une Amérique prospère le jour.
Articles actuels de l’auteur