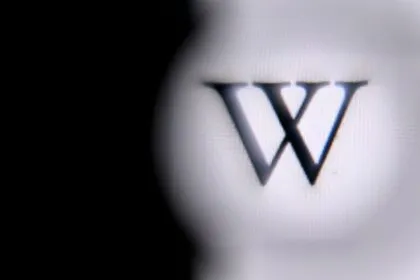Opinion
Insécurité, l’addition salée : l’enquête sur une « défaillance d’État » de Christophe Éoche-Duval

Christophe Éoche-Duval, haut fonctionnaire.
Photo: DR
ENTRETIEN – « Le niveau d’insécurité explose en France », entend-on de toutes parts, comme un refrain angoissé. Mais qui s’interroge sur le prix réel de cette insécurité pour la Nation ? C’est ce flou comptable que vient dissiper Le prix de l’Insécurité – Enquête sur une défaillance d’État (Éditions Eyrolles), sous la plume de Christophe Eoche-Duval. Combien la France consacre-t-elle réellement à sa sécurité intérieure, à la justice, aux forces de l’ordre, et à cette myriade de dispositifs éparpillés dans les méandres de l’administration ? Et surtout, pour quels résultats ? Avec une méthodologie prudente, le haut fonctionnaire tente l’exercice périlleux du chiffrage. Le résultat : une addition vertigineuse, opaque, mal suivie. Mais plus qu’un simple audit, ce livre se veut aussi un cri d’alarme civique. En s’appuyant sur les principes fondateurs de 1789, l’auteur plaide pour des réformes à la fois simples et peu onéreuses, visant à rétablir la sécurité comme un droit fondamental, et à replacer l’État non pas dans le rôle du témoin impuissant, mais dans celui du garant responsable.
Epoch Times : « Dans notre société où domine l’argent, il est édifiant de constater que le coût économique de la lutte contre l’insécurité est si mal étudié, si peu débattu et encore moins si peu communiqué », écrivez-vous. Comment expliquer un tel angle mort dans le débat public ?
Christophe Éoche-Duval : Pour moi, ce sujet relève de la sidération. Je redoutais un sujet éculé ; j’ai découvert une terre en friche. Seuls quelques chercheurs, auxquels je rends hommage, s’y étaient aventurés, et leurs travaux, bien que précieux, commencent à dater. Mon apport, si je puis dire, est une mise à jour destinée au grand public, construite selon une méthodologie rigoureuse. Car cette lacune n’est pas anodine : elle constitue une faute politique majeure de l’ensemble de nos politiques publiques de sécurité.
Voyez-vous, l’État n’est pas gouverné comme une grande entreprise responsable. Son système comptable évoque plutôt un tonneau des Danaïdes rempli par un aveugle.
Le « déni sécuritaire » ou le « relativisme sécuritaire » dont souffre notre pays trouve, selon moi, sa source principale dans l’incapacité des responsables publics à dresser un diagnostic objectif, impartial, et scientifiquement fondé de l’insécurité. C’est pourtant la condition pour que tous les Français en prennent conscience, au-delà des clivages, et que le Parlement, dans tous groupes confondus, s’en saisisse pleinement.
Prenons une comparaison simple : lorsque je participe à l’assemblée générale de ma copropriété, le syndic est tenu de fournir des comptes sincères et certifiés. Sans cela, comment voter en connaissance de cause ? Or, notre démocratie s’enlise dans une technocratie déconnectée : c’est un danger.
Dans mon essai, je formule plusieurs propositions simples, peu coûteuses, mais de bon sens : que les budgets des collectivités locales comportent une annexe « sécurité » indiquant clairement leur part d’investissement ; que la LOLF (Loi organique relative aux lois de finances) impose aux administrations de l’État une comptabilité analytique incluant une ligne « sécurité » ; que la Cour des comptes consolide chaque année les dépenses de sécurité de la Nation ; et qu’enfin, le Parlement s’en saisisse pour sa certification politique et en débatte, démocratiquement !
Vous estimez la dépense publique consacrée à la sécurité intérieure à 36,2 milliards d’euros en 2020. Que recoupe ce chiffre et sur quelles sources et méthodologies vous appuyez-vous pour parvenir à ce résultat ?
Dans mon essai, j’ai volontairement limité ma recherche à l’année 2020. À la date de mes travaux, c’était le millésime pour lequel les données disponibles étaient les plus complètes et accessibles. Inutile de se précipiter vers des mises à jour annuelles : les ordres de grandeur restent globalement constants. Hélas, une constante demeure également — ils sont orientés à la hausse.
L’État mobilise en priorité des budgets pour financer ce que l’on désigne comme la « sécurité intérieure ». Les Armées, relevant de la « sécurité extérieure », constituent un autre domaine, bien qu’il faille, dans une transparence parfois digne de l’opacité, réintégrer les efforts qu’elles consacrent à la lutte contre certaines formes de criminalité. C’est notamment le cas des opérations conjointes entre la Marine nationale et les Douanes contre le trafic de drogue en mer.
La sécurité intérieure relève principalement du ministère de l’Intérieur, mais aussi de celui de la Justice. D’autres ministères civils disposent également de polices administratives spécifiques : songez, par exemple, à la police de l’environnement, placée sous l’autorité du ministère de l’Écologie.
Pour évaluer les dépenses, j’ai dû moi-même plonger dans les méandres des comptes de l’État et de la Loi de finances initiale (LFI) pour 2020. J’invite le lecteur à se reporter à mon enquête pour le détail. Faute de disposer des moyens d’investigation de la Cour des comptes, mon approche se veut prudente : elle est du côté de la sous-évaluation, jamais de la sur-évaluation. Ce que mes travaux révèlent, en revanche, c’est une réelle opacité dans la comptabilité publique.
J’aboutis ainsi à un chiffre de 36,2 milliards d’euros pour la seule sécurité intérieure en 2020. Mais ce n’est qu’un des étages d’une addition plus large. En prenant en compte les autres strates de la dépense sécuritaire, j’estime le coût global entre 169,1 et 176,1 milliards d’euros pour cette même année, selon que l’on retienne une hypothèse basse ou haute, dont j’explicite la méthode.
Qu’une Nation consacre 7 à 8 points de son PIB à sa sécurité n’a rien d’anormal en soi. Ce qui l’est, en revanche, c’est que cette réalité ne soit ni connue avec rigueur, ni débattue. Et plus grave encore : que les Français n’aient pas le sentiment de bénéficier, en retour, d’un niveau d’efficacité à la hauteur de cet effort colossal.
Vous rappelez que les plaintes déposées constituent l’un des indicateurs tangibles de l’insécurité. Entre 2010 et 2020, on en compte entre 4 et 5 millions chaque année. Or, en 2020, près des trois quarts – précisément 74,3 % – ont été classées sans suite. Et même parmi les 5 % qui donnent lieu à une instruction, beaucoup échouent malgré tout dans les limbes judiciaires après une brève enquête préliminaire. Vous soulignez en outre que ces chiffres ne reflètent qu’une partie du phénomène, puisque la moitié des victimes ne porte même pas plainte. Selon une enquête de victimation de l’INSEE, huit millions de personnes ont été victimes d’une infraction en 2018. Comment expliquer qu’un tel volume de signalements débouche sur si peu de poursuites effectives ?
Il existe un écart criant entre les faits vécus et les statistiques « officielles ». Pour en illustrer la portée concrète, permettez-moi de livrer à vos lecteurs une anecdote personnelle récente qui met en lumière la sous-évaluation structurelle de la délinquance en France. Ce phénomène n’est sans doute pas propre à notre pays, mais la France se revendique comme une grande puissance : ses carences en matière d’État ne sauraient donc excuser les défaillances de sa démocratie.
J’ai été victime d’un vol à l’arraché. Comme je le recommande dans mon essai — car il ne faut jamais rien laisser passer — j’ai entrepris de porter plainte. Je décide de le faire en ligne. Encore faut-il, pour cela, disposer d’une connexion internet, ce qui n’est pas le cas de 15 % de nos concitoyens en situation d’illectronisme. Puis, il faut franchir la barrière technique de l’authentification via « FranceConnect ».
Déjà, on restreint drastiquement l’accès à ceux qui ont un certain niveau de familiarité numérique. J’ai franchi ces obstacles, puis patienté, attendant que le commissariat destinataire me convoque pour la signature de la plainte — ce qui, soit dit en passant, est paradoxal : l’e-plainte était censée faire gagner du temps, à la fois pour l’administration et pour le citoyen.
Plus d’une semaine s’écoule. Un message vocal d’un policier me signale que, ayant mentionné un léger mal au cou consécutif à l’arrachage, ma plainte ne peut être prise en ligne : « Navré, c’est un vol avec violence, il faut vous présenter physiquement au commissariat, et pendant les horaires d’ouverture. »
J’avais donc perdu mon temps. J’ai dû tout recommencer. Me rendre au commissariat à 9h, attendre mon tour jusqu’à 11h30, et sacrifier ma matinée. Combien de Français renoncent, découragés, à déposer plainte ? Et ce, alors même qu’ils savent que cette démarche n’aboutira à rien : pas d’enquête, pas de suite, pas de prise en charge, et souvent, pas même de couverture par l’assurance — les vols à l’arraché ne sont plus systématiquement indemnisés.
Combien de nos compatriotes, même sans vivre cette expérience d’impuissance, ont d’ores et déjà perdu toute confiance dans l’utilité de cette démarche civique ? L’intuition collective est là : au terme de ce parcours du combattant, leur plainte sera classée sans suite dans 73,6 % des cas, en moyenne.
Pardonnez-moi cette anecdote, mais elle en dit souvent bien plus que les chiffres. Ces chiffres, je les expose dans mon essai, pour montrer comment l’État « aménage » ses statistiques, jouant sur un « sentiment d’insécurité » que l’on prétend inférieur à la réalité. Or, la réalité, c’est qu’un fait sur deux, voire plus, échappe aux radars. Pourquoi ? Parce que la victime, découragée, se tait.
Dans votre ouvrage, vous citez Christian Jackowski, directeur de l’Institut de médecine légale de Berne, selon qui il pourrait exister autant de crimes non détectés que de crimes détectés. Que cela nous dit-il, selon vous, du réel niveau de l’insécurité et des limites de sa mesure ?
Puisqu’en France, il ne reste plus guère que le droit de « voter en lisant », je formule l’espoir que nombre de nos concitoyens découvrent mon Enquête sur une défaillance d’État — ainsi titré en sous-titre de mon essai. Plus ils seront nombreux à en prendre connaissance, plus ils exigeront des comptes à nos gouvernants.
La « zone grise » de la criminalité n’est pas une singularité française. Elle est bien connue dans de nombreuses démocraties. Un médecin légiste suisse, que je cite, le démontre de manière éclairante. Mais le fait que ce phénomène ne soit pas exclusivement national n’exonère en rien nos responsabilités : une nation développée comme la France se doit de mieux faire, notamment dans un domaine encore cruellement négligé — le renseignement judiciaire.
Ce pan entier de la politique de sécurité publique reste embryonnaire. Il mériterait à lui seul un futur essai.
Le recul du taux d’élucidation des crimes et délits, souvent mis en avant, s’explique par de nombreux facteurs. Mais l’un des éléments centraux, trop peu évoqué, est bel et bien l’absence d’une politique structurée de renseignement judiciaire. À cette carence structurelle, s’ajoute un retard technologique inquiétant. Là où d’autres pays investissent dans l’intelligence artificielle pour recouper la masse des faits, nous en sommes encore à l’âge de pierre, de la main courante jusqu’à l’enquête approfondie.
Dans votre ouvrage, vous mentionnez un chiffre particulièrement saisissant : d’ici cinq ans, le nombre d’agents de sécurité privée pourrait atteindre 200.000, se rapprochant ainsi du total des forces publiques — 274.000 policiers et gendarmes actuellement en poste. Quel regard portez-vous sur cette progression fulgurante du rôle croissant confié au secteur privé dans le maintien de l’ordre ?
Les trajectoires sont claires : les effectifs de la sécurité privée sont en train de rattraper ceux des forces de l’ordre publiques : nos hommes et femmes en « bleu ». En tant que citoyen, juriste, et lecteur des penseurs comme Montesquieu, Tocqueville… mais aussi d’Orwell, cette évolution m’inspire une profonde inquiétude.
Des asymétries deviennent visibles. Par exemple : un agent de sécurité privée peut fouiller un cabas à l’entrée d’un supermarché, tandis qu’un policier, sur la voie publique, devra affronter une complexité procédurale autrement plus stricte pour opérer un contrôle similaire. C’est le signe d’un déséquilibre préoccupant.
Ce déséquilibre est la marque d’un échec : celui de l’État à garantir, à lui seul, le contrat social de sécurité. De plus en plus d’acteurs économiques, et même de simples particuliers, ne peuvent plus se reposer sur la « garantie » que l’État français devrait incarner. Cet État qui, à juste titre, nous a ôté le droit à l’autodéfense, nous distinguant en cela des États-Unis, se montre désormais incapable d’assumer pleinement la contrepartie de ce monopole : la protection effective.
C’est ce cri d’alarme civique que je porte dans mon essai : ne vous laissez plus voler votre droit fondamental à la sécurité.
Ce droit n’est pas accessoire. Il figure en seconde position dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, sous le nom de « droit à la sûreté » : un synonyme, en vocabulaire du XVIIIe siècle, de ce que nous appelons aujourd’hui la sécurité. Pourtant, notre République, et nos juges, n’ont pas su hiérarchiser ces droits dans l’ordre des obligations de l’État à l’égard de ses citoyens.
Je revendique une réforme de principe : ériger la sécurité en « obligation de résultat » pour l’État, avec à la clé des conséquences juridiques concrètes. En cas de manquement grave, l’État devrait être sanctionné pécuniairement, au profit des victimes. Car le droit de vivre sain et sauf n’est pas une abstraction. Près de 9 homicides sur 10 révèlent une défaillance d’État.
Mes pensées vont à Monique, 73 ans, ancienne infirmière, atrocement battue à mort le 26 mars 2025. Son meurtrier ? Un récidiviste comptant 24 condamnations — pour vols, violences, agressions sexuelles — remis en liberté en décembre 2024. Ce n’est pas une tragédie inévitable. C’est la faute de l’État, dont il reste impuni.

Le prix de l’insécurité : Enquête sur une défaillance d’État, Christophe Éoche-Duval (Eyrolles), 18€
Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles d’Epoch Times.

Etienne Fauchaire est un journaliste d'Epoch Times basé à Paris, spécialisé dans la politique française et les relations franco-américaines.
Articles actuels de l’auteur