Opinion
Le dérapage budgétaire annoncé des Jeux olympiques de Paris

La façade de l'hôtel de ville de Paris lors des Jeux olympiques de Paris 2024.
Photo: Le Segretain/Getty Images
Le 23 juin 2025, la Cour des comptes a publié son rapport sur Les dépenses publiques liées aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 : premier recensement qui chiffre à près de 6 milliards d’euros les dépenses publiques pour les JO de Paris 2024.
La Cour a évalué « les dépenses d’organisation à 2,77 milliards d’euros » dont 1,4 milliard pour la sécurité, et celles liées aux infrastructures à 3,19 milliards d’euros. Sans données fiables, la Cour a indiqué ne pas avoir pris en compte « les effets positifs et négatifs des Jeux sur l’activité économique », on pense notamment à la fermeture des commerces au centre de Paris ayant fortement pesé sur le chiffre d’affaires des commerçants.
Jusqu’à présent, seuls les comptes du comité d’organisation (Cojo), évalué à 4,4 milliards en dépenses, avaient été communiqués, reposant quasi essentiellement sur des financements privés, ceux de la Solideo (comprenant une part publique) et la manne de la vente des billets. De ces bénéfices, rien ne sera rendu aux Français, alors que ce sont 6 milliards d’euros d’argent public qui y a participé.
Si l’événement a été un succès populaire et sportif, le dépassement de la facture soulève des questions de transparence et de maîtrise des coûts, alors que le Cojo assurait un équilibre budgétaire et que les organisateurs s’accordaient des salaires mirobolants.
Et dans ce calcul, le plan de nettoyage de la Seine de 1,4 milliard d’euros, une aubaine certes pour la faune et la flore locales, n’est pas compté, alors qu’il était présenté comme un des accomplissements majeurs de l’évènement sportif.
Le rapport intervient dans un contexte budgétaire tendu, avec les Français contraints à des restrictions économiques dans le Budget 2025 et celles attendues dans le Budget 2026, ainsi qu’à une inflation des prix à la consommation qui n’est pas vraiment descendue.
Un coût global provisoire de 5,96 milliards d’euros
Selon la Cour des comptes, les dépenses publiques liées aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 s’élèvent à 5,96 milliards d’euros, un montant qu’elle déclare être provisoire en attendant d’autres enquêtes.
Cette somme se répartit en deux grandes catégories : 2,77 milliards d’euros pour l’organisation des Jeux et 3,19 milliards d’euros pour les infrastructures. Ce chiffrage dépasse largement les estimations initiales, qui tablaient sur environ 2,8 milliards d’euros dans le projet de loi de finances 2025.
Le rapport souligne que ce montant est encore partiel, car certaines données, notamment celles des collectivités territoriales, restent indisponibles. Un bilan définitif est attendu pour octobre 2025.
1,4 milliard pour une Seine « baignable »… non comptabilisé
Selon le rapport, les Jeux ont été marqués par l’organisation des épreuves olympiques de triathlon et de natation en eau libre dans la Seine. Le fleuve a constitué un élément phare de la candidature, l’objectif étant d’en assurer la « baignabilité » en 2024. Les pouvoirs publics s’étaient alors fortement mobilisés.
Mais selon la Cour des Comptes, l’enjeu de la baignabilité de la Seine n’est pas directement à compter dans l’organisation des Jeux. Il s’agissait plutôt de répondre à des obligations environnementales fixées par plusieurs textes européens et des projets plus anciens. À ce stade, la Cour des comptes estime que les coûts de cette “baignabilité” imputables aux Jeux oscillent « entre 200 millions et 1 milliard d’euros » et que compte tenu de « cette incertitude », ils n’ont pas été intégrés dans l’évaluation.
Les investissements liés à sa mise en œuvre ont été estimés à 1,4 milliard d’euros, majoritairement payés par l’État et les collectivités territoriales
Un déploiement des forces de l’ordre inédit
Parmi le coût global des dépenses publiques sur les Jeux, 2,77 milliards d’euros couvrent les frais opérationnels nécessaires au déroulement de l’événement. Le poste le plus important est celui de la sécurité avec 1,44 milliard d’euros. L’État a financé 95 % de ces dépenses.
La sécurité a mobilisé des moyens exceptionnels dans un contexte géopolitique tendu et des menaces d’attentat au moment des Jeux. Quelque 35.000 forces de l’ordre ont été mobilisées et le centre historique de Paris a été complètement barricadé pendant plusieurs semaines et accessible uniquement par un QR Code.
L’usage de drones et de systèmes anti-drones, ainsi que des outils de cybersécurité comme la vidéosurveillance algorithmique, a aussi alourdi la facture. La sécurisation de la cérémonie d’ouverture sur la Seine, une première mondiale, a requis des moyens humains et matériels hors-norme, pour une cérémonie d’ouverture qui a finalement choqué une partie du monde entier.
Les 1,04 milliard d’euros restants des frais opérationnels incluent des dépenses variées, telles que la logistique événementielle (signalétique, gestion des flux de spectateurs), les services aux athlètes (restauration, transports), et les frais liés à l’animation culturelle (cérémonies, fan zones).
Les dépenses publiques dans les infrastructures
Pour les 3,19 milliards d’euros investis dans les infrastructures sportives, ces dépenses, largement portées par la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo), concernent la construction et la rénovation de 70 sites, dont le village olympique, le centre aquatique de Saint-Denis et le village des médias. Sur ce total, 2,23 milliards d’euros proviennent directement des budgets publics, dont 1,65 milliard via la Solideo et 581,8 millions de financements complémentaires.
Situé en Seine-Saint-Denis, le village olympique a coûté environ 1,7 milliard d’euros, dont une part significative venant de fonds publics. Conçu pour être transformé en logements après les Jeux, il incarnait l’ambition d’un héritage durable, mais son coût élevé suscite des débats sur sa rentabilité à long terme. Quant au village des médias, quatre mois après les JO, des logements étaient déjà insalubres.
Quant au centre aquatique olympique de Saint-Denis, qui devait être dédié aux épreuves de natation, il s’est finalement avéré trop petit. Quelque 175 millions d’euros d’argent public ont été dépensés, pour que ce soit finalement Nanterre qui accueille les compétitions principales.
Les collectivités territoriales ont ensuite financé les trois quarts des 573 millions d’euros consacrés aux équipements sportifs des sites de compétition (stades, gymnases, bassins). Ces investissements, souvent accélérés pour les Jeux, avaient pour but de bénéficier aux clubs locaux et aux habitants, qui devront quand même, après en avoir payé la construction, en payer l’entrée.
Le coût des aménagements urbains et des transports
Un total de 839,2 millions d’euros a été investi dans des projets d’aménagement urbain, notamment en Seine-Saint-Denis. Ces travaux incluent l’enfouissement de lignes à haute tension, la requalification de zones dégradées et l’amélioration des espaces publics.
Si ces projets ont été accélérés grâce aux Jeux, le rapport souligne qu’ils ne sont pas exclusivement imputables à l’événement, ce qui complique leur chiffrage.
Les Jeux ont catalysé des investissements dans les transports, avec 345 millions d’euros dépensés, notamment pour l’extension de la ligne 14 du métro parisien. Ces travaux, bien que planifiés avant les Jeux, ont été accélérés pour répondre aux besoins de mobilité des spectateurs et des athlètes.
Par ailleurs, 280,5 millions d’euros ont été consacrés à la sécurisation des sites d’infrastructures, incluant des mesures de protection environnementale.
Un dérapage budgétaire annoncé
Déjà en février 2024, une étude du cabinet Asterès annonçait que les dépenses publiques s’élèveraient à 5,2 milliards d’euros, pour un budget total de 11,8 milliards d’euros, en comptant le budget du Cojop. La Cour des comptes parlait déjà d’un coût pour les finances publiques entre 3 et 5 milliards d’euros.
Concernant son propre budget, le Cojo assurait que la compétition était financée à 96 % par de l’argent privé, principalement grâce aux sponsors (1,24 milliard), au Comité international olympique (1,2 milliard) et à la billetterie (1,4 milliard). Une polémique était née suite à la divulgation des salaires extravagants des dirigeants du Cojo, qui représentait un demi-milliard d’euros de masse salariale.
Mais si le budget du Cojo est bien arrivé à l’équilibre avec 4,2 milliards d’argent privé, du côté des dépenses publiques, on craignait déjà un dérapage de plusieurs milliards d’euros des dépenses publiques, aux frais du contribuable.
La ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra, avait alors réfuté tout dérapage budgétaire en assurant devant les députés qu’il n’y avait « pas de coût caché ni de dérive budgétaire » s’agissant de la facture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris.
Le comité d’organisation des JO, qui fermera ses portes le 30 juin, trouve, quant à lui, que le rapport de la Cour des comptes a ratissé bien large. Il juge que le chiffrage est « disproportionné par rapport à la réalité », estimait auprès de quelques journalistes son directeur financier Fabrice Lacroix, qui évalue la facture publique plutôt « autour de deux milliards d’euros ».
Un suivi budgétaire plus strict demandé pour les JO de 2030
Le rapport de la Cour des comptes souhaitait aussi tirer la sonnette d’alarme pour les Jeux d’hiver 2030 organisés par la France. La Cour recommande une meilleure coordination entre les acteurs publics et privés, un suivi budgétaire plus strict et une transparence accrue sur les coûts indirects. Ces recommandations sont d’autant plus cruciales que la loi olympique pour 2030 est en cours d’examen au Sénat.
Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles d’Epoch Times.
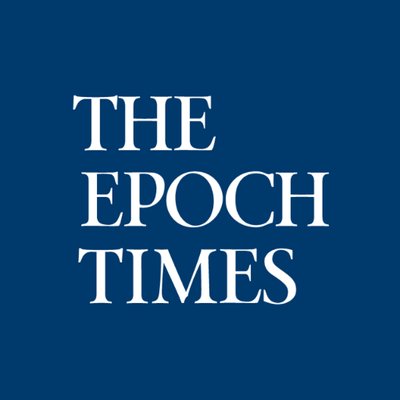
Histoire et philosophie des sciences, Science de l'information. Actualités française et internationale.
Articles actuels de l’auteur









