Opinion
Première en dépenses et dernière de la classe : qu’est-ce qui cloche avec l’école primaire française ?

Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici
Photo: Bertrand GUAY / AFP
L’éducation est souvent décrite comme le socle d’une société prospère, un levier essentiel pour former les citoyens de demain et garantir la compétitivité économique d’un pays.
Pourtant, dans son rapport publié le 20 mai 2025, la Cour des comptes dresse un constat alarmant sur l’état de l’enseignement primaire en France. Dans le rapport L’Enseignement primaire : une évolution impérative, la juridiction financière de l’ordre administratif français documente des failles structurelles profondes qui compromettent la qualité de l’éducation dispensée aux élèves.
Malgré un investissement public massif de 55,1 milliards d’euros en 2023, les résultats des élèves, notamment en mathématiques, placent la France en queue de peloton des pays de l’Union européenne et de l’OCDE.
La Cour des comptes appelle à une réforme urgente pour répondre aux besoins des élèves et faire remonter le niveau à l’école primaire, jugé « inacceptable ».
Un investissement massif pour des résultats plus que moyens
Ce paradoxe – des moyens importants pour des résultats médiocres – est au cœur du rapport de la Cour des comptes, qui commence par un état des lieux sans concession : les performances des élèves français en fin d’école primaire, particulièrement en CM1, sont préoccupantes.
Avec 55,1 milliards d’euros dépensés en 2023 pour l’enseignement primaire, la France se situe parmi les pays européens qui investissent le plus par élève. Pourtant, cet effort financier ne se traduit pas par des résultats à la hauteur.
Selon l’étude TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), la France se classe dernière en mathématiques parmi les pays de l’Union européenne et 42e sur 58 pays au niveau mondial, loin derrière des nations comme Singapour, l’Angleterre ou la Pologne. En lecture et compréhension, les performances stagnent, et les écarts entre élèves de milieux favorisés et défavorisés s’aggravent dès les premières années de scolarité.
La TIMSS révèle une baisse progressive du niveau des élèves, particulièrement marquée chez les plus performants. « Les meilleurs élèves français, ceux qui devraient tirer le système vers le haut, s’effacent progressivement jusqu’à la fin de la sixième », note le rapport.
Cette régression est d’autant plus inquiétante qu’elle intervient dans un contexte où les compétences en mathématiques et en sciences sont cruciales pour répondre aux défis d’un monde en pleine transformation technologique.
Mais les mathématiques ne sont pas le seul domaine en difficulté. En français, les compétences en lecture et en compréhension stagnent, et les inégalités entre élèves se creusent dès les premières années de scolarité.
Le rapport souligne que les écarts de performance entre les élèves issus de milieux favorisés et ceux des milieux défavorisés s’aggravent au fil du cycle primaire. « L’école primaire, censée poser les bases d’une éducation équitable, aggrave les inégalités sociales au lieu de les réduire », déplore la Cour.
Des dysfonctionnements structurels au cœur du problème
Pour expliquer cet échec, la Cour des comptes identifie plusieurs dysfonctionnements structurels.
Le premier concerne la gouvernance de l’école primaire, jugée « trop centralisée ». Malgré des tentatives de décentralisation, les décisions clés restent prises au niveau national, laissant peu de marge de manœuvre aux établissements pour s’adapter aux besoins spécifiques de leurs élèves.
Cette rigidité bureaucratique freine l’innovation pédagogique et limite la capacité des écoles à répondre aux défis locaux, qu’il s’agisse de lutter contre le décrochage scolaire ou de soutenir les élèves en difficulté.
Un autre problème majeur réside dans l’organisation du temps scolaire, qualifiée de « décalée par rapport aux besoins des élèves ». Le rapport pointe une répartition des heures d’enseignement qui ne prend pas suffisamment en compte les rythmes biologiques des enfants, notamment les plus jeunes. Les journées scolaires, souvent longues et denses, fatiguent les élèves et nuisent à leur concentration. « Le système est en décalage avec les besoins de l’enfant » selon la Cour des comptes.
Un autre point soulevé par le rapport concerne la gestion des absences des enseignants. Ce problème persiste dans le primaire, où les absences pour raisons de santé ou autres motifs perturbent le suivi des élèves. Le système de remplacement, bien que renforcé dans certaines académies (Amiens, Bordeaux, Créteil, Strasbourg), reste insuffisant, et les élèves se retrouvent parfois sans enseignant pendant plusieurs jours.
Enfin, la crise de l’attractivité du métier d’enseignant constitue un obstacle majeur. Avec un salaire de départ d’environ 26.000 euros par an, les enseignants français sont moins bien payés que leurs collègues allemands (51.000 euros) ou singapouriens, où la profession jouit d’un prestige social élevé. Cette faible rémunération, combinée à une charge administrative croissante et à des conditions de travail difficiles, décourage les candidats.
La comparaison avec les modèles éducatifs d’autres pays
D’autres pays ont des performances éducatives remarquables, qui leur permettent d’être en haut des classements internationaux, bien que la question des disparités sociales sur certains territoires européens soit un problème récurrent.
La Finlande, régulièrement en tête des classements PISA, est un modèle d’excellence éducative. Avec des classes de 19,3 élèves en moyenne (contre 22 en France), elle, privilégie une approche centrée sur l’élève, avec des journées courtes, des pauses fréquentes et un accent mis sur le bien-être. Les enseignants, formés au niveau d’un master et bénéficiant d’un statut social élevé, disposent d’une grande autonomie pour adapter leurs méthodes. Contrairement à la France, où l’enseignement repose souvent sur la mémorisation, la Finlande favorise la pensée critique et la créativité, ce qui explique ses résultats exceptionnels en lecture, mathématiques et sciences.
Singapour domine les classements TIMSS grâce à un système axé sur les fondamentaux dès le plus jeune âge. Avec un ratio de 15 élèves par enseignant, les enseignants, bien formés et rémunérés (salaires compétitifs et prestige social), assurent un suivi individualisé. Les méthodes pédagogiques combinent rigueur académique, résolution de problèmes et travaux pratiques, contrairement à l’approche française, souvent trop théorique. Singapour investit également dans le soutien aux élèves défavorisés, réduisant les inégalités sociales, un domaine où la France peine à progresser.
L’Allemagne, avec un ratio de 14,9 élèves par enseignant, surpasse la France en mathématiques et sciences dans les évaluations TIMSS. Son système décentralisé, géré par les Länder, permet une adaptation des programmes aux besoins locaux, contrairement à la centralisation française. Les enseignants, mieux payés (51.000 euros en début de carrière) et bénéficiant d’un volume horaire réduit (701 heures par an), travaillent dans de meilleures conditions. Cependant, comme en France, l’Allemagne lutte contre des inégalités sociales marquées, bien qu’elle compense par des politiques ciblées.
Au Royaume-Uni, les écoles primaires jouissent d’une grande autonomie, favorisant des pédagogies variées. Avec environ 700 heures d’enseignement par an, les journées sont mieux équilibrées qu’en France (864 heures annuelles en primaire), et les résultats en mathématiques et sciences dépassent ceux des élèves français. Toutefois, les inégalités sociales restent aussi un défi.
Une aggravation des inégalités d’apprentissage
L’un des aspects les plus préoccupants du rapport concerne l’aggravation des inégalités d’apprentissage au cours du cycle primaire.
Les élèves issus de milieux sociaux en difficulté, qui représentent une part importante des effectifs dans certaines académies, accusent un retard croissant en lecture, écriture et calcul. Ce phénomène est particulièrement marqué dans les zones d’éducation prioritaire (REP et REP+), où les moyens humains et matériels, bien que renforcés, ne suffisent pas à compenser les écarts, dans des populations d’origine à majorité immigrée.
Le rapport souligne également les disparités géographiques. Les écoles situées en milieu rural ou dans les quartiers défavorisés souffrent d’un manque chronique d’enseignants qualifiés, de ressources pédagogiques et d’infrastructures adaptées.
À l’inverse, les établissements des grandes villes ou des zones aisées bénéficient souvent de meilleures conditions, ce qui renforce les inégalités territoriales. « L’école primaire est à deux vitesses », déplore la Cour.
S’inspirer des modèles étrangers
Face à ce diagnostic sévère, la Cour des comptes formule une série de recommandations. Ces propositions visent à transformer en profondeur l’école primaire française pour la rendre plus efficace.
La Cour plaide pour une décentralisation et une autonomie accrue des établissements, qui permettraient aux directeurs d’école et aux équipes pédagogiques de prendre des décisions adaptées à leur contexte local.
Une réforme des rythmes scolaires est jugée indispensable. La Cour des comptes propose des journées plus courtes pour les plus jeunes, avec des pauses mieux réparties et des activités périscolaires intégrées au temps scolaire pour réduire la fatigue et favoriser l’apprentissage.
Pour attirer et fidéliser les enseignants, le rapport suggère une revalorisation salariale, une simplification des tâches administratives et à plus de formation continue. Il insiste également sur l’importance de soutenir les enseignants dans les zones prioritaires, où les défis sont les plus grands.
La Cour appelle aussi à un renforcement des moyens dans les zones défavorisées, avec des classes à effectifs réduits et un accompagnement personnalisé pour les élèves en difficulté, afin d’adapter l’enseignement aux besoins de chaque élève.
Malgré ce constat alarmant, la Cour des comptes met en avant des initiatives locales positives et prometteuses, comme des projets pédagogiques innovants dans certaines écoles ou des programmes de formation continue qui portent leurs fruits.
Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles d’Epoch Times.
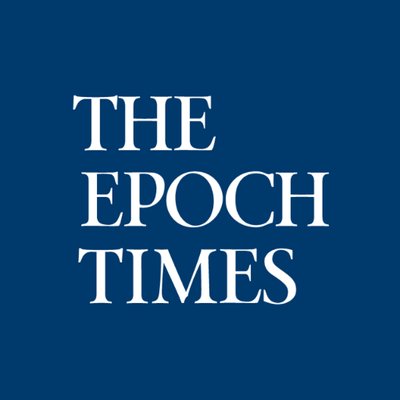
Histoire et philosophie des sciences, Science de l'information. Actualités française et internationale.
Articles actuels de l’auteur









