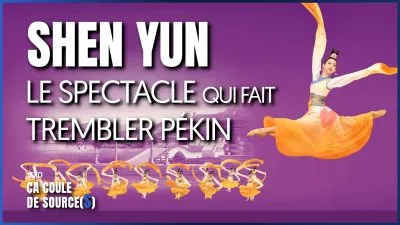Perte et gain : trois interprétations artistiques d’Orphée et Eurydice

« Orphée et Eurydice », 1893, d'Auguste Rodin.
Photo: Domaine public
L’histoire d’Orphée et d’Eurydice est une histoire tragique de la mythologie gréco-romaine. Orphée était un poète et un musicien célèbre, et Eurydice était sa chère épouse. Un jour, alors qu’elle tentait de fuir la poursuite d’Aristée, Eurydice fut mortellement mordue par un serpent. Accablé de chagrin, Orphée se rendit aux Enfers pour supplier Hadès de libérer sa femme.
Grâce à l’harmonie de sa lyre, le poète-musicien réussit à charmer les esprits des Enfers. Hadès et Perséphone (déesse des Enfers) acceptent de laisser Eurydice revenir dans le monde des vivants à une condition : Orphée doit la guider hors des Enfers sans se retourner vers elle jusqu’à ce qu’ils atteignent le monde des vivants. Alors, dans le moment qui définit le mythe, comme le raconte Ovide, « ils touchent à la surface de la terre, lorsque, tremblant de la perdre, inquiet, impatient de la voir, Orphée tourne la tête. Soudain elle est réentraînée dans l’abîme ».
Le cœur brisé une fois de plus, cette fois par la seconde et éternelle mort de sa femme bien-aimée, Orphée erre dans le désert de Thrace, désespéré, se lamentant sur cette double perte au son de sa lyre. Au cours de cette période de deuil, Orphée connaît un destin tragique aux mains des Ménades, les femmes disciples de Dionysos.
L’acte même de création – qu’il s’agisse de musique, de conversation, de poésie, d’amitié, de peinture ou de sculpture – est un processus qui met en jeu la relation entre la perte et le gain. Le geste de regarder en arrière, en particulier dans le mythe d’Orphée et d’Eurydice, est une métaphore pertinente du travail d’un artiste. Lorsqu’Orphée se retourne pour regarder Eurydice, il perd sa femme mais gagne son image dans sa poésie.
De la même manière, les artistes s’engagent dans la relation entre la perte et le gain afin de produire leurs visions artistiques. Une grande partie du processus créatif consiste à abandonner et à sacrifier les premières ébauches au service de visions artistiques ultérieures plus raffinées. Les artistes utilisent le silence, le papier, l’argile, le marbre, la toile et leurs outils respectifs pour regarder en arrière, en travaillant sur un morceau fragmenté d’une réalité désordonnée pour créer une vision unifiée qui contient l’enregistrement de leur processus d’abandon.
Gestes sacrificiels

Orphée et Eurydice, 1830, par Carl Andreas August Goos. Huile sur toile. Galerie nationale du Danemark, Copenhague. (Domaine public)
Lorsque je considère le geste de se retourner, et plus précisément le mouvement de regarder en arrière, l’image qui me vient le plus à l’esprit est celle d’Orphée se retournant pour regarder sa femme Eurydice. Près du seuil du monde vivant, sa forme se perd dans la brume. Bien que le mythe ne soit pas explicitement mentionné dans les récits de Virgile ou d’Ovide, j’imagine un moment de contact visuel entre les amants, où la connaissance partagée de la fin imminente d’Eurydice est communiquée juste avant que sa silhouette ne se disperse, « comme une fumée qui se mêle à l’air, disparue au loin », comme le mentionne le livre quatre des Géorgiques de Virgile.
Dans le récit de Virgile, ce moment de suspension est suffisamment long pour qu’Eurydice prononce quatre vers troublants, alors que l’Eurydice d’Ovide intériorise ces vers en une simple pensée de tendresse pour son mari, ne prononçant qu’un adieu à peine discernable. Le regard en arrière d’Orphée se lit comme suit : « Il s’arrêta et, à la limite de la lumière, inconscient, hélas, et vaincu dans son dessein, il se retourna vers Eurydice, maintenant retrouvée. »
En renonçant au corps de chair d’Eurydice dans son moment de rétrospection, Orphée acquiert une dernière image de sa femme et du chagrin que cette seconde perte évoque. Cette perte est à l’origine de son chant, une complainte belle et obsédante qui attire l’attention d’une myriade de créatures vivant dans les étendues sauvages de Thrace :
« On raconte que pendant sept mois entiers, jour après jour, il a pleuré sous un rocher élevé, près du ruisseau solitaire de Strymon, et qu’à l’abri des vallées fraîches, il a raconté son histoire, charmant les tigres et attirant les chênes par son chant : comme le rossignol qui, à l’ombre d’un peuplier, pleure la perte de ses petits, lorsqu’un laboureur sans cœur, surveillant leur lieu de repos, les a arrachés du nid : la mère pleure toute la nuit, tandis que, perchée sur une branche, elle répète son chant malheureux et remplit tout l’entourage de lamentations plaintives. »
Ainsi, en écho à la première complainte qui a incité les habitants des enfers à donner une autre vie à Eurydice, cette deuxième mélodie des pleurs d’Orphée naît en réponse à une nouvelle mort de l’épouse du poète. L’abandon d’Eurydice (l’objet de la passion, de l’amour et du désir d’Orphée) et l’émergence concomitante d’un chant déchirant sont analogues au processus dans lequel s’engagent tous les artistes, quelle que soit leur discipline.
Le tableau de Jean-Baptiste-Camille Corot Orphée ramenant Eurydice des Enfers, les Nymphes trouvant la tête d’Orphée de John William Waterhouse et Orphée et Eurydice d’Auguste Rodin sont trois interprétations artistiques du mythe d’Orphée et Eurydice, qui trouve ses racines dans les Géorgiques de Virgile et les Métamorphoses d’Ovide. Chacun de ces artistes utilise son art respectif – la peinture à l’huile ou le marbre – pour transmettre différents moments du mythe.
La composition de Corot

Orphée ramenant Eurydice des Enfers, 1861, par Jean-Baptiste-Camille Corot. Huile sur toile ; 113 cm x 137 cm. Musée des Beaux-Arts de Houston. (Domaine public)
Le tableau de Jean-Baptiste-Camille Corot Orphée ramenant Eurydice des Enfers évoque une atmosphère éthérée en manipulant les caractéristiques de la peinture à l’huile. Corot choisit une palette de gris, de verts et de bleus peu chromatiques pour décrire les esprits de l’Hadès et les fourrés environnants, laissant les rares teintes de chair pour accompagner la silhouette d’Orphée.
L’un des avantages de la peinture à l’huile est que son rapport pigment-liant peut être régulé, ce qui signifie que la densité des particules minérales par rapport à l’huile dans laquelle elles sont suspendues peut être ajustée et superposée, simulant de manière convaincante les effets de différentes textures. L’analyse technique de coupes transversales de peintures de Corot, ainsi que des anecdotes de ses élèves, révèlent que le peintre ajoutait des résines (pin, copal, mastic et baume de sapin) et des pigments transparents à ses peintures, modifiant les propriétés de manipulation afin d’obtenir une translucidité semblable à celle d’un glacis lors de l’application.
En outre, Corot utilisait souvent un pinceau sec pour rendre le caractère du feuillage, en le chargeant de pigments et en permettant à ses poils rugueux d’inciser les taches de peinture. Ainsi, l’aura sombre que dégage Orphée ramenant Eurydice des Enfers est le fruit d’une manipulation minutieuse des matériaux picturaux. Virgile écrit : « Stimulées par son chant, les ombres insubstantielles, les fantômes de ceux qui gisent dans les ténèbres, sont montés du plus bas royaume de l’Érèbe« . Corot exprime les vers du poète en peinture, en modulant la gamme de valeurs des esprits à l’arrière-plan du tableau, en les gardant décolorés et peu contrastés, obscurcis dans la brume au-delà des portails de Dis.
Bien qu’Orphée et Eurydice soient représentés avant le moment où le poète se retourne, la fin tragique de l’histoire est préfigurée par l’atmosphère de la toile dans son ensemble : la gamme de tons étroite, peinte comme si elle était infléchie par un filtre de grisaille, surplombe la composition avec un sentiment de perte imminente.
Dans ses derniers tableaux (dont Orphée ramenant Eurydice des Enfers), Corot laissait souvent des parties de son ébauche (sous-peinture) brun pâle visibles dans sa composition finale, créant ainsi l’illusion de la profondeur en établissant un contraste entre la peinture appliquée en couche mince et la peinture appliquée en couche épaisse. Orphée tient triomphalement sa lyre en l’air dans un geste qui traduit la victoire de son art, qui touche même ceux qui se trouvent au plus profond de l’enfer, comme le décrit Ovide :
Tandis qu’il parlait, s’accompagnant des accords de sa lyre,
Il arrachait des larmes aux âmes exsangues ;
Tantale cessa de saisir l’onde toujours fuyante
Les vautours ne rongèrent plus leur foie,
Les Bélides laissèrent leurs urnes,
Et toi, Sisyphe, tu t’assis sur ton rocher.
Ce fut la première fois, dit la tradition,
Que se mouillèrent de larmes les joues des Euménides,
Vaincues par son chant ;
L’épouse du roi, ni non plus le roi des Enfers,
N’ont le cœur de repousser sa prière.
Ils appellent Eurydice.
Elle se trouvait parmi les Ombres arrivées récemment,
Et elle s’avança d’un pas ralenti par sa blessure.
Le héros du Rhodope obtient de la reprendre, à une condition :
Celle de ne pas tourner ses regards en arrière,
Avant d’être sorti des vallées de l’Averne ; sinon, la faveur sera annulée.
Les teintes les plus chaudes et les plus chromatiques d’une peinture – par ailleurs monochrome – sont réservées à la figure d’Orphée lui-même, à sa couronne de laurier et à sa lyre, symbole de son identité de poète-musicien. En effet, bien que le moment de la seconde mort d’Eurydice ne soit pas représenté dans le tableau de Corot, quiconque connaît le mythe et lit la teneur solennelle de la toile perçoit que sans la tragédie imminente, la toile perdrait son effet émotionnel.
Le rendu de Rodin

Orphée et Eurydice, 1893, d’Auguste Rodin. Marbre : 123 cm x 79 cm x 64 cm. Metropolitan Museum of Art, New York. (Domaine public)
Le marbre est un support contre-intuitif pour transmettre un esprit, car la matérialité dure de la pierre va à l’encontre de la nature vaporeuse et fumante de l’âme désincarnée. En d’autres termes, le matériau ne se prête pas instinctivement à ce qu’il cherche à exprimer visuellement. En contemplant la manière dont un esprit pourrait être représenté avec succès, on pourrait évoquer les textures de la gaze, des voiles, du tulle ou de la brume – des textures diaphanes qui se prêtent naturellement à l’articulation par le biais d’un support plus indulgent que la pierre.
Cependant, Rodin, dans sa sculpture en marbre Orphée et Eurydice, raconte avec succès sa propre interprétation du mythe de Virgile, rivalisant avec la composition de Corot et nous rappelant le « paragone », le débat de la Renaissance italienne dans lequel la sculpture et la peinture étaient chacune défendue comme la forme d’art régnante.
Rodin utilise le bloc de marbre inachevé et texturé autant que sa partie raffinée pour décrire les formes d’Orphée et d’Eurydice lors de leur remontée des enfers. L’arrière de la tête d’Eurydice ne s’est pas détaché de la pierre d’où elle émerge, une petite touffe de marbre inachevée relie le bras gauche d’Eurydice à l’omoplate de son amant, et un gros morceau de pierre texturée reste entre les jambes du couple, appuyant sur le fessier d’Orphée et le quadriceps de sa femme.
Ces masses de marbre inachevé, brut et texturé sont efficaces pour transmettre une atmosphère de brouillard dense ou d’occlusion nuageuse. La figure d’Eurydice peut être lue comme un palimpseste, car elle est une reprise de la figure de la Martyr de Rodin, issue de son projet de la Porte de l’Enfer, un ensemble de portes en bronze commandées en 1880 pour illustrer la Divine Comédie. Ce projet n’a jamais abouti in situ, mais le sculpteur y a travaillé de manière obsessionnelle pendant près de 37 ans. Ainsi, Eurydice renferme une figure de l’une des 200 figures contorsionnées dans les affres de l’Enfer qui peuplent les portes de bronze.
Avec le sacrifice d’Eurydice, l’objet vers lequel Orphée oriente son amour est éludé ; le poète comble alors cette lacune par la musique. Ainsi, le sacrifice d’un attachement aimé (en particulier celui qui, auparavant, donnait au poète une identité et imprégnait sa vie d’un sens) permet la naissance de l’art.
De même, le travail du sculpteur est soustractif. Afin d’obtenir une image plus raffinée, le sculpteur doit ciseler le marbre, sacrifier – ou enlever – de la matière pour faire naître l’œuvre d’art.
Le portrait de Waterhouse

Nymphes trouvant la tête d’Orphée, 1900, par John William Waterhouse. Huile sur toile ; 148 cm x 108 cm. Collection privée. (Domaine public)
Dans son tableau de 1900 intitulé Nymphes trouvant la tête d’Orphée, John William Waterhouse dépeint une partie tardive du mythe d’Orphée, après la mort du poète-musicien aux mains des femmes du Cicon. Deux belles femmes sont perchées sur les rives de l’Hébra, regardant dans l’eau la tête décapitée d’Orphée. Les ménades (dont le nom vient du verbe grec signifiant « se déchaîner », « être fou » ou « délirer »), furieuses de voir Orphée repousser leurs avances et se lamenter sans cesse sur la perte d’Eurydice, avaient lapidé le poète et éparpillé ses membres dans les terres sauvages de Thrace.
Les deux naïades représentées dans le tableau de Waterhouse tombent donc sur la tête du poète qui flotte en aval avec sa lyre. Ovide décrit comment la langue inerte du poète murmure encore, sa lyre à la dérive gratte encore, et les rives du fleuve, les oiseaux et les arbres répondent à sa complainte. Même mort, nous pouvons voir qu’Orphée est beau, partageant les traits esthétiques des belles naïades.
La composition de Waterhouse est très contrastée, la peau des deux nymphes et la tête d’Orphée brillant sur une toile de fond sombre et boisée. Une fine bande orange pâle sur la silhouette bleue des montagnes au loin suggère que la scène se déroule au coucher du soleil. La naïade à droite porte une robe lilas et rose et saisit une cruche en cuivre alors qu’elle regarde dans l’eau.
Sa cruche indique qu’elle et son amie sont venues à la rivière pour laver leurs vêtements ou puiser de l’eau, et qu’elles sont tombées par hasard sur Orphée et sa lyre. La naïade de gauche porte une robe bleue avec une ceinture rouge drapée sur les cuisses, sa main gauche s’agrippe à une branche d’arbre pour se stabiliser, tandis que sa main droite s’appuie sur le rebord rocheux de la rive.
Alors que Corot et Rodin ont choisi de représenter un moment différent de l’histoire d’Orphée, un moment où Eurydice était encore physiquement présente, l’interprétation du mythe par Waterhouse évoque sa présence tout aussi fortement à travers son absence. La tête flottante d’Orphée est enlacée par sa lyre, l’instrument qui a permis à Eurydice d’avoir une seconde chance de vivre et qui a conduit le poète-musicien à sa propre perte alors qu’il était en deuil. En l’absence de la figure d’Eurydice dans le tableau, les sentiments de nostalgie et de tourment sont omniprésents. Corot et Waterhouse utilisent la peinture à l’huile tandis que Rodin utilise le marbre pour raconter l’histoire d’un poète dont l’art est né du sacrifice de sa chère femme et a conduit au sien.
Mari Otsu est titulaire d'une licence en histoire de l'art et en psychologie. Elle a appris le dessin classique et la peinture à l'huile dans le cadre d’un programme du Grand Central Atelier.
Articles actuels de l’auteur
22 novembre 2025
Pourquoi les scientifiques modernes aspirent à la spiritualité