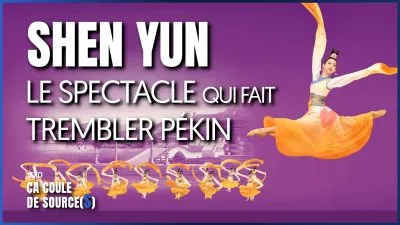Euthanasie, aide à mourir, soin… l’importance du choix des mots et la confusion que cela entraîne dans le public

Manifestation organisée par l'association "La Marche pour la vie" à Paris en janvier 2023.
Photo: JULIEN DE ROSA/AFP via Getty Images
Au Québec, l’injection létale administrée dans le cadre de l’Aide médicale à mourir est appelée un soin, au même titre que tout traitement administré à un patient dans le but d’améliorer sa santé. En France, le président Emmanuel Macron a déjà commencé à utiliser le même vocabulaire que chez nos cousins Outre-Atlantique, retenant le terme « aide à mourir » plutôt qu’ « euthanasie », et ce dès le mois de mars.
Dans ce deuxième article d’une série sur l’expérience du Québec dans le domaine de l’Aide médicale à mourir (AMM), nous continuons à nous entretenir avec le professeur de philosophie et auteur québécois Louis-André Richard. Ce dernier se penche sur la question de la fin de vie depuis une vingtaine d’années et a participé à la consultation publique du Québec en 2010 qui a précédé l’adoption de la loi sur les soins de fin de vie.
Dans un premier article, nous avons résumé son expérience et ses observations pendant le processus de consultation ainsi que ses réflexions sur l’évolution de l’AMM au Québec, champion mondial de l’euthanasie. Le sujet étant trop souvent présenté noir ou blanc alors qu’il est en fait composé de multiples nuances de gris, nous avons divisé la réflexion en différents thèmes faisant chacun l’objet d’un article séparé.
Louis-André Richard nous explique ici son point de vue de philosophe au sujet du choix des termes utilisés pour tout ce qui a trait à l’euthanasie. Selon lui, ce vocabulaire fait école un peu partout sur la planète. La France, pays où M. Richard se rend régulièrement pour traiter de la question, ne fait pas exception.
L’ « aide à mourir », ça fait moins peur que l’ « euthanasie »
« Les mots ont de l’importance et il faut essayer de bien nommer le réel sans créer d’ambiguïtés », a déclaré Emmanuel Macron dans un entretien avec La Croix et Libération en mars dernier, lorsqu’il a annoncé le nouveau projet de loi sur la fin de vie. « Le terme que nous avons retenu est celui d’aide à mourir parce qu’il est simple et humain et qu’il définit bien ce dont il s’agit », a justifié le président français.
Du point de vue du professeur de philosophie Louis-André Richard, ce choix de mots est pourtant « hallucinant » puisque l’expression « aide à mourir » peut être comprise dans un sens et dans son contraire. « C’est vraiment une expression qui correspond au novlangue de 1984 de George Orwell », commente-t-il.
M. Richard explique : « On peut dire qu’en soins palliatifs, on aide médicalement quelqu’un à mourir en l’accompagnant jusqu’au terme de son existence. Plus explicite et a contrario, on peut poser un geste létal qui interrompt la vie du patient dans la population en général. C’est un concept politiquement rassurant, qui fait beaucoup moins peur que si j’utilisais ‘suicide assisté’ ou ‘euthanasie’. »
Au Québec, comme nous l’avons vu dans l’article précédent, l’expression « aide médicale à mourir » a également été inventée pour pallier des questions juridiques puisque l’euthanasie était illégale selon la loi fédérale de l’époque où la loi québécoise a été adoptée.
On ne soigne pas par l’euthanasie
Faire de l’euthanasie un soin et l’appeler « aide active à mourir » participe à la confusion dans le public, selon le professeur de philosophie qui se penche sur la question de l’éthique. Il se bat pour éviter les amalgames : « Il faut rester attaché aux mots et à ce qu’ils veulent dire », assure-t-il. « Une grande perversion de la loi, c’est d’avoir fait de l’euthanasie un soin. »
« Le soin, par définition, ça ne supprime jamais son objet. Un soin, son objet, c’est de maintenir le soigné et si possible de lui permettre de recouvrer la santé », explique Louis-André Richard. Pourtant, aujourd’hui au Québec, on a tendance à percevoir l’AMM comme faisant partie intégrante d’un continuum des soins offerts par les médecins, une option supplémentaire parmi celles déjà disponibles.
Le choix de ce terme a également des conséquences sur les médecins. « À partir du moment où le Collège des médecins a fait de l’euthanasie un soin et l’a intégré dans la panoplie des soins offerts, les médecins sont contraints », déplore l’auteur. Même si le médecin a le choix de refuser d’euthanasier une personne, il a quand même l’obligation de trouver quelqu’un qui va le faire parce que cela fait partie du code de déontologie médicale.
Dans sa thèse, le philosophe va plus loin et interroge au sujet de ce droit de refus des médecins. De quelle manière appliquer le droit des patients à avoir recours à l’AMM tout en respectant le droit de refus du personnel médical ? Comment s’assurer qu’il y ait un bassin suffisant de personnes disposées à poser le geste euthanasique, bien réparties sur le territoire ? Comment réagir en cas de déséquilibre entre le nombre de demandes et le nombre de personnel médical acceptant de dispenser l’euthanasie ? Faudra-t-il obliger les médecins à la pratiquer à un moment donné ?
On peut se demander aussi quel est l’impact psychologique sur les soignants qui acceptent de pratiquer l’euthanasie. « Je pose la question, je ne donne pas de réponse, mais il est possible que cela entraîne des effets néfastes sur la psyché de celle ou de celui qui, même s’il le fait au nom de la compassion, entraine la mort du patient », interroge M. Richard.
L’impact sur la psyché d’un médecin n’est certainement pas le même s’il pratique une sédation ou bien l’euthanasie. « Quand vous pratiquez l’euthanasie, vous provoquez la mort dans un geste délibéré. On vous donne le permis de tuer, le même permis qu’on donne aux militaires. Le même permis qu’on donnait aux bourreaux à l’époque où la peine de mort était légale. Le même permis qu’on donne aux policiers qui ont un port d’arme. Ces gens-là, s’ils sont amenés dans l’exercice de leurs fonctions, à enlever la vie à quelqu’un, même si c’est le pire des bandits, ce n’est pas sans conséquence sur eux, sur leur équilibre psychologique », remarque le philosophe.
Ne pas amalgamer soins palliatifs et euthanasie
Louis-André Richard se rend régulièrement depuis une quinzaine d’années au congrès de la Société française d’accompagnement palliatifs (SFAP) en France. Il assurera la plénière d’ouverture du congrès 2024 en juin à Poitiers. Très au fait de la question française, il a donc quelques conseils à prodiguer aux Français.
« À mon avis, il faut éviter à tout prix l’amalgame, c’est-à-dire faire du soin palliatif une option amalgamée à ce qu’on appelle maintenant les soins de fin de vie. Je pense que l’avenir des soins palliatifs, si avenir il y a, cela doit être en mode résistance », recommande-t-il, remarquant que les Français savent bien mieux résister à l’oppresseur que les Québécois, selon ses observations.
« Je pense que d’un point de vue de philosophie politique, l’avenir des soins palliatifs passe par cette posture », estime-t-il, espérant qu’il y aura des gens courageux pour l’assumer jusqu’au bout.
Afin de bien montrer le risque qui existe en France, M. Richard prend l’exemple du Québec, où les soins palliatifs se retrouvent assimilés par la loi de fin de vie, avec une assimilation qui va de plus en plus vite. Dans les faits, cela se traduit par le départ en retraite des soignants les plus âgés, « ceux qui maîtrisent bien les codes du soin palliatif ». Les jeunes qui arrivent dans la profession bénéficient donc de moins en moins du mentorat nécessaire pour bien comprendre l’art d’accompagner une personne en fin de vie. Résultat ? pour eux, il est bien plus simple d’utiliser la trousse « euthanasie » que de comprendre, mais surtout d’assimiler ou d’intégrer, le protocole d’accompagnement en soins palliatifs.
« Quelqu’un qui va passer, ne serait-ce que dix ans de sa vie, à accompagner au quotidien des mourants, développe une sensibilité, une qualité d’accompagnement. Cela fait partie de la qualité des soins palliatifs. Si vous êtes un médecin euthanasieur et que vous faites dix euthanasies par semaine, ce n’est pas pareil. Il y a un accompagnement, certes, mais ce n’est pas pareil. Alors moi, je plaide pour la dissociation des deux modes d’accompagnement », explique le professeur de philosophie.
Louis-André Richard croit qu’il va être difficile de lutter contre la future loi française, « parce que de toute évidence, elle va venir, peu importe ce qui se passe ». Toutefois, même s’il est « déjà presque trop tard », il pense que les Français ne doivent pas abdiquer et devraient lutter, et plus particulièrement contre les termes utilisés.
La France sur les pas du Québec
« Je pense qu’une leçon que les Français doivent absolument tirer rapidement avant même que la loi arrive, c’est de refuser l’assimilation, parce que cela fait partie du projet idéologique de confondre les deux concepts [euthanasie et soins palliatifs, ndlr]. Et de ce point de vue-là, pour boucler la boucle, le vocabulaire y participe d’emblée », assure l’auteur.
Lorsque la loi québécoise a été votée, il y avait encore la distinction entre les différents termes. Les Québécois y tenaient. Cette distinction n’a toutefois pas tenu longtemps, ce qui a mené à la situation actuelle, où les maisons de soins palliatifs sont maintenant obligées de pratiquer l’AMM dans leurs murs, déplore le philosophe.
Les politiciens québécois ont défendu leur projet de loi en disant que cette loi n’avait pas pour but de favoriser l’euthanasie, mais de favoriser les soins palliatifs en y ajoutant un service supplémentaire. Le philosophe constate que « c’est un peu la même logique qu’on essaie d’établir en France ».
« Vous êtes en train d’aller exactement dans le même sens », prévient M. Richard.
Les travaux de Louis-André Richard reposent sur l’observation de terrain tout en s’ancrant profondément dans la lecture de grandes œuvres philosophiques — Platon, Aristote, Saint Augustin ou Alexis de Tocqueville. Il a entre autres écrit sur le thème de la fin de vie une thèse de doctorat qui a reçu en 2016 le prix d’auteur pour l’édition savante du Conseil canadien de recherches en sciences humaines. Cette thèse a été publiée aux éditions Hermann sous le titre La Cigogne de Minerve. Philosophie, culture palliative et société.
Premier article de notre série. Aide à mourir : l’expérience du Québec, champion mondial de l’euthanasie

Articles actuels de l’auteur