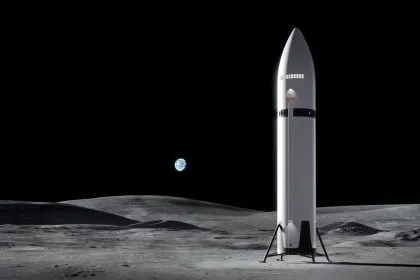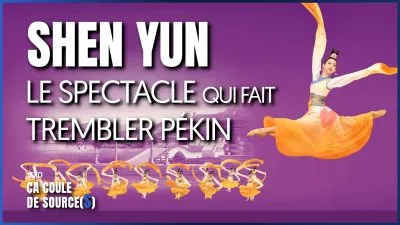Le pape François décède à 88 ans des suites d’un accident vasculaire cérébral et d’une insuffisance cardiaque

Le pape François au Vatican, le 4 décembre 2024.
Photo: FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images
Le souverain pontife est décédé à l’âge de 88 ans, laissant derrière lui un héritage de réformes ambitieuses, non exemptes de controverses.
Le pape François était le premier chef de l’Église catholique romaine originaire d’Amérique latine.
Évêque de Rome, Vicaire de Jésus-Christ, Successeur du Prince des Apôtres, Souverain Pontife de l’Église universelle, Primat d’Italie, Archevêque et Métropolite de la province de Rome, Souverain de l’État de la Cité du Vatican, Serviteur des serviteurs de Dieu, et autrefois connu comme le cardinal Jorge Mario Bergoglio, archevêque de Buenos Aires en Argentine, le pape François Ier s’est éteint le lundi 21 avril à 7 h 35. Il était âgé de 88 ans.
Souffrant depuis longtemps d’une maladie pulmonaire chronique et ayant subi l’ablation partielle d’un poumon dans sa jeunesse, il avait été hospitalisé en février dernier à la suite d’une crise respiratoire, qui avait évolué en double pneumonie. Il y a passé 38 jours — la plus longue hospitalisation de son pontificat, entamé il y a douze ans.
Il laisse derrière lui une Église forte de 1,3 milliard de fidèles et un héritage façonné par une volonté affirmée de réforme sociale et politique, tant au sein qu’en dehors de l’institution catholique, inspirée de son interprétation des enseignements de Jésus-Christ sur la miséricorde.
Cependant, ces réformes — en particulier celles touchant à l’environnement, à l’accueil des migrants en situation irrégulière et à l’ouverture envers la communauté LGBT — ont souvent été au cœur de vives polémiques et de réactions hostiles de la part des milieux conservateurs.
Avant d’être pape
François, alors Jorge Mario Bergoglio, fut ordonné prêtre le 13 décembre 1969 et consacra plus de cinquante ans à la vie religieuse. Il fut nommé évêque auxiliaire de Buenos Aires en 1992, puis installé comme archevêque le 28 février 1998. Créé cardinal en 2001, il participa au conclave de 2005 qui élut le pape Benoît XVI.
Mais sa vocation naquit bien plus tôt : le 21 septembre 1953, alors âgé de 17 ans, une impulsion soudaine le poussa à entrer dans une église pour se confesser alors qu’il se rendait à une fête. Cette expérience marqua un tournant.
« Après cette confession, j’ai senti que quelque chose avait changé », confia-t-il en 2013. « Je n’étais plus le même. J’ai entendu une voix, un appel : j’étais convaincu que je devais devenir prêtre. Cette expérience de foi est essentielle. Nous disons que nous devons chercher Dieu, aller vers Lui pour demander pardon, mais en réalité, Il nous attend déjà. »
Il entra au noviciat des Jésuites, leur rigoureux programme de formation, le 11 mars 1958, après avoir souffert d’une pneumonie sévère l’année précédente, ce qui lui coûta une partie de son poumon droit.
Il prononça ses vœux perpétuels comme jésuite en 1973 et dirigea la province jésuite d’Argentine et d’Uruguay jusqu’en 1979.
Durant cette période, il dut faire face à l’enlèvement de deux prêtres jésuites, les pères Ferenc Jalics et Orlando Yorio, par la junte militaire au cours de la « guerre sale » argentine.
« Dans le quartier où ils travaillaient, il y avait une cellule de guérilla. Mais les deux jésuites n’avaient rien à voir avec elle : ils étaient des pasteurs, non des militants », expliqua le pape en 2023 lors d’une rencontre avec des jésuites hongrois à Budapest. « Ils étaient innocents. Ils ont été détenus neuf mois, menacés, torturés, puis relâchés. Ce genre d’épreuves laisse des blessures profondes. »
Jorge Mario Bergoglio fut ensuite recteur et professeur de théologie au Colegio Máximo d’Argentine jusqu’en 1985, avant de partir en Allemagne pour y achever sa thèse doctorale.
Il puisa son inspiration religieuse dans l’histoire de saint Matthieu, collecteur d’impôts et pécheur public, que Jésus appela à devenir Apôtre.
« C’est le combat entre la miséricorde et le péché », disait-il lors d’une homélie en 2017. « Et comment l’amour de Jésus est-il entré dans le cœur de cet homme ? Parce qu’il se savait pécheur. La première condition pour être sauvé, c’est de se savoir en danger ; la première condition pour guérir, c’est de se savoir malade. »
De Bergoglio à François
Son pontificat débuta le 13 mars 2013 et fut marqué par de nombreux précédents. Il fut le premier pape jésuite, le premier originaire de l’hémisphère occidental, le premier à s’adresser au G7, et le premier à consacrer une encyclique entière à la foi et au changement climatique.
Dès sa première apparition, il fut salué pour sa simplicité, arborant une tenue blanche sobre plutôt que les fastes traditionnels. Il se fit apôtre de la miséricorde qui l’avait transformé.
Dès son premier Jeudi saint, il remplaça le rituel du lavement des pieds de 12 clercs par celui de 12 détenus, dont certains musulmans.
L’année suivante, il célébra le mariage de plusieurs couples vivant en union libre, parfois avec enfants — une occasion que l’une des mariées avait cru à jamais inaccessible.
Il canonisa près de 1000 saints, dont 813 en une seule fois : les martyrs d’Otrante, tués par les Ottomans en 1480 pour avoir refusé de se convertir à l’islam. Parmi les autres canonisés : les papes Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, ainsi que Junipero Serra, missionnaire franciscain en Californie.
Il fut également très actif sur la scène internationale, s’adressant à l’Union européenne, au Forum économique mondial, aux sommets du G7 et du G20 sur des questions allant de l’immigration au climat, en passant par l’intelligence artificielle. Il accueillit son propre sommet sur le climat et joua un rôle diplomatique dans le rapprochement entre les États-Unis et Cuba.
Il appela à une action urgente contre le changement climatique et exhorta les gouvernements occidentaux à protéger les migrants sans papiers, critiquant les politiques migratoires restrictives de l’administration Trump.
Son règne s’achève durant l’Année jubilaire de l’Espérance, qu’il souhaitait marquée par la fin des conflits, des réinstallations pacifiques de réfugiés, des guérisons et l’annulation des dettes.
Polémiques
Son pontificat, toutefois, ne fut pas sans remous, et naquit même d’une rupture : celle de la renonciation du pape Benoît XVI en 2013 — événement rare, survenu seulement trois fois dans l’histoire de l’Église.
Ses appels à la compassion — notamment ses directives récentes sur la bénédiction de couples homosexuels, ses critiques du capitalisme ou de la politique migratoire des États-Unis — suscitèrent l’opposition de nombreux conservateurs, notamment américains, certains allant jusqu’à le qualifier de marxiste.
Il répondit lui-même à ces accusations : « Si je lis l’Évangile uniquement d’un point de vue sociologique, alors oui, je suis communiste — et Jésus aussi. Mais ce message des Béatitudes et de Matthieu 25, c’est celui du Christ. Les communistes nous ont volé certaines de nos valeurs chrétiennes. »
Il maintint une tolérance envers les autres religions qui inquiéta certains fidèles, soucieux de voir l’Église céder au relativisme moral.
S’exprimant en septembre 2024 en Indonésie devant des religieux et des laïcs, il affirma : « Annoncer l’Évangile ne signifie pas imposer notre foi ou la poser en opposition à celle des autres, mais partager la joie de la rencontre avec le Christ, dans le respect et l’affection fraternelle pour chacun. »
Il conclut également un accord avec le Parti communiste chinois, donnant à celui-ci un droit de regard sur la nomination des évêques dans le pays — une rupture nette avec la politique ferme de Jean-Paul II à l’égard des régimes communistes.
Il fit par ailleurs destituer en 2023 Mgr Joseph Strickland, évêque du diocèse de Tyler, au Texas, opposé à sa ligne. Aucune raison officielle ne fut donnée.
Son insistance sur le dialogue restreignit également l’usage de la messe en latin traditionnel, ce qui contraria une frange croissante de jeunes fidèles attachés aux formes liturgiques anciennes.
Néanmoins, il réaffirma des éléments doctrinaux fondamentaux : l’importance des sacrements, l’indissolubilité du mariage entre un homme et une femme, le sacerdoce exclusivement masculin et la défense de la vie dès la conception.
L’un de ses derniers messages fut adressé, le 28 janvier dernier, à la Faculté de théologie du Triveneto, en Italie : « Je vous encourage à poursuivre la mission de l’Église, fidèles à la tradition authentique, mais ouverts à la lecture des signes des temps. Cela suppose de relever courageusement les défis nouveaux pour transmettre l’Évangile à l’homme contemporain. »
Et maintenant ?
Dans les jours à venir, le cardinal camérier — le plus haut responsable administratif du Vatican — convoquera plus de 100 cardinaux du monde entier pour élire un nouveau pape.
Reclus au sein du palais apostolique, ils prieront, débattront et voteront à bulletin secret. L’élection requiert une majorité des deux tiers et peut s’étaler sur plusieurs jours, avec jusqu’à quatre scrutins quotidiens. Après chaque vote, les bulletins sont brûlés : la fumée noire indique qu’aucune majorité n’a été atteinte, la fumée blanche qu’un pape a été élu.
Dès que le candidat accepte la charge, l’annonce est faite au monde : « Habemus papam » (« Nous avons un pape »).

Depuis Tampa, en Floride, TJ couvre principalement l'actualité météorologique et politique nationale.
Articles actuels de l’auteur
01 décembre 2025
Donald Trump confirme s’être entretenu avec Nicolás Maduro
22 octobre 2025
SpaceX perd la garantie du premier alunissage